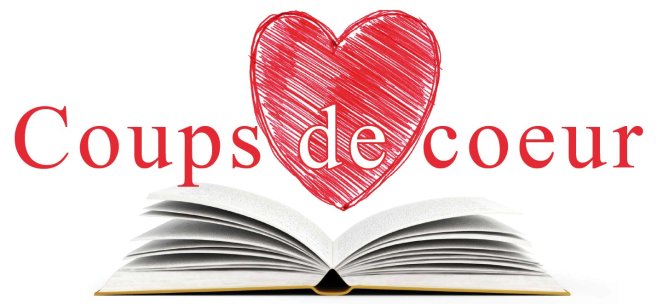Titre: La mer en hiver
Auteur: Susanna Kearsley
Genre: Romance / Historique
Nombre de pages: 464
Date de sortie: 09/10/2015
Prix support papier: 22€50
Prix format numérique: 16€99
ISBN: 978-2368120323
Editions: Charleston
Synopsis:
Printemps 1708, une flotte jacobite de soldats français et écossais échoue à faire revenir James Stewart, le roi exilé, sur ses terres d'Écosse afin de réclamer sa couronne.
De nos jours, Carrie McClelland s'inspire de cet épisode historique dans son nouveau roman. Installée aux abords du château de Slains, au coeur d'un paysage écossais désolé et magnifique, elle crée une héroïne portant le nom d'une de ses ancêtres, Sophia, et commence à écrire.
Mais elle se rend compte que ses mots acquièrent une vie propre et que les lignes entre fiction et faits historiques se brouillent de plus en plus. Tandis que les souvenirs de Sophia attirent Carrie encore plus au coeur de l'intrigue de 1708, elle découvre une histoire d'amour fascinante, oubliée avec le temps. Après trois cents ans, le secret de Sophia doit être révélé…
Une histoire d'amour puissante et ensorcelante, entre passé et présent !
Mon avis:
Une excellente lecture que je vous conseille vraiment de lire.
Je remercie chaleureusement les Éditions Charleston pour cette magnifique découverte et plus particulièrement Élise.
Je remercie chaleureusement les Éditions Charleston pour cette magnifique découverte et plus particulièrement Élise.
Ma notation:
Vous l'avez lu ? Notez-le:
Informations:
Ce roman contient 19 chapitres
Mes ressentis:
Carrie McClelland est une auteure à succès qui est en pleine écriture de son nouveau roman. Lors d'une visite à Cruden Bay en Écosse, elle tombe littéralement sous le charme de cet endroit, de ses paysages et plus particulièrement de son château. C'est tout naturellement qu'elle décide de partir de la France afin de s'installer sur place dans un petit cottage. Ce lieu inspire Carrie et c'est avec aisance et facilité qu'elle se met à écrire son livre dicté par ses rêves.
Un roman troublant qui vous embarquera forcément tant par l'histoire de l’héroïne que par son roman que nous découvrons également. Eh oui, c'est un double roman ! Un livre dans un livre :)
Les faits nous saisissent, le fond de l'histoire nous transperce et je vous promets qu'il est impossible de passer à côté de ce roman et de ne pas l'aimer.
Nous suivons d'un côté Carrie, son quotidien, son travail autour de ses écrits, ses recherches à la bibliothèque ou avec son papa, ses ressentis, mais aussi ses rencontres et ses histoires de cœur. D'un autre côté, nous découvrons l’histoire de Sophia, l’ancêtre de Carrie, cette femme qui vit au début du 18e siècle et qui, elle aussi, vit une histoire d'amour entre autres choses...
Elle (re)prend vie dans le livre de Carrie. Un côté historique, extrêmement bien écrit qui donne envie d'aimer l'Écosse et d'en connaître un petit peu plus sur ce pays et son histoire. L'ensemble est très bien construit et nous apprend beaucoup de choses. L'auteure Susanna Kearsley n'a pas lésiné sur ses recherches et sur sa manière de nous les transmettre, c'est très plaisant.
Elle (re)prend vie dans le livre de Carrie. Un côté historique, extrêmement bien écrit qui donne envie d'aimer l'Écosse et d'en connaître un petit peu plus sur ce pays et son histoire. L'ensemble est très bien construit et nous apprend beaucoup de choses. L'auteure Susanna Kearsley n'a pas lésiné sur ses recherches et sur sa manière de nous les transmettre, c'est très plaisant.
J'ai a-do-ré ! Pour ma part, c'est un presque coup de cœur. J'ai pris mon temps, je l'ai savouré, je n'avais pas envie de le terminer, de tourner les dernières pages, de quitter les personnages, j'ai donc mis presque deux semaines avant de le refermer, mais c'était exactement de cette façon que je devais et que j'avais envie de le lire. C'est un livre cocooning, un bouquin que l'on fait traîner, on apprécie chaque mot, chaque phrase et plus on avance dans les chapitres plus notre attachement devient fort.
Une lecture rare, une pépite, un trésor que je vous conseille vraiment de lire !
Extrait:
CHAPITRE 1
Ce n’était pas un hasard. Rien de tout cela n’était arrivé par simple hasard.
Je l’appris plus tard ; même si j’eus du mal à accepter cette évidence quand elle me frappa, car j’avais toujours cru fermement à l’autodétermination. Jusque-là, ma vie avait semblé corroborer cette idée – j’avais choisi certaines voies qui m’avaient menée à certaines fi ns, toutes positives, et je considérais
les quelques contretemps rencontrés le long de la route non comme de la malchance, mais comme de simples fruits de mon jugement imparfait. Si j’avais dû choisir un credo, j’aurais opté pour ces deux vers du poète William Henley, vibrants de courage : Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ainsi, lorsque tout commença en ce matin d’hiver, quand j’allai chercher la voiture que j’avais louée et que je quittai Aberdeen pour me diriger vers le nord, l’idée que quelqu’un d’autre puisse être à la barre ne m’effleura pas une seconde. Je croyais sincèrement que m’éloigner de la route principale pour emprunter celle qui longeait la rive découlait de ma propre décision. Sans doute pas la meilleure décision qui soit, d’ailleurs, étant donné que les routes étaient bordées de la neige la plus épaisse qui s’était abattue sur l’Écosse depuis quarante ans, et que l’on m’avait avertie des risques de dérapages et de retards. La prudence et le fait que j’aie un rendez-vous auraient dû m’inciter à rester sur la grand-route, plus sûre, mais le petit panneau indiquant « Route côtière » me fit dévier.
Mon père me disait toujours que j’avais la mer dans le sang. J’étais née et j’avais grandi sur la côte de la Nouvelle-Écosse, et je n’avais jamais pu résister à l’attrait des vagues. Alors, quand la route principale tourna vers l’intérieur des terres, je préférai bifurquer à droite et emprunter la voie côtière.
Je ne pourrais pas dire à quelle distance je me trouvais lorsque j’aperçus sur les falaises le château en ruine, une ligne d’obscurité dentée se détachant sur un ciel nuageux, mais dès l’instant où je le vis, je fus captivée et accélérai. Je ne prêtai aucune attention aux grappes de maisons se dressant sur mon passage et sentis une pointe de déception lorsque la route repartit dans la direction opposée. Mais ensuite, derrière un bois touffu, la route tourna de nouveau et il surgit devant moi : un château sombre abandonné, s’élevant au milieu des champs enneigés qui s’étendaient entre la route et le bord de la falaise, comme pour en interdire l’accès.
Je remarquai un parking un peu plus haut, un petit espace plat jonché de bûches pour délimiter les emplacements et, sans réfléchir, j’allai m’y garer. Il était vide. Pas étonnant, sachant qu’il n’était pas encore midi et que c’était une journée froide et venteuse. En outre, il n’y avait aucune raison de s’arrêter là à moins de vouloir observer les ruines. Et un coup d’œil vers le seul chemin susceptible
d’y mener – un sentier de ferme gelé, couvert de congères plus hautes que mes genoux – me suffit pour deviner qu’il n’y aurait pas foule à y faire escale ce jour-là. Je savais que moi-même je ne devais pas m’arrêter. Je n’en avais pas le temps. Je devais être à Peterhead pour treize heures.
Mais quelque chose en moi ressentait le besoin soudain de savoir exactement où je me trouvais ; je sortis donc mon plan. J’avais passé les cinq mois précédents en France ; c’était là que j’avais acheté ma carte et elle avait ses limites, plus préoccupée par les routes et les autoroutes que par les villages et les ruines. Je scrutais si intensément le gribouillis représentant le littoral, essayant de déchiffrer les noms en petits caractères, que je ne remarquai pas l’homme avant qu’il me dépasse, d’un pas lent, les mains dans les poches, un épagneul aux pattes boueuses sur les talons. Cela me semblait être un endroit étrange pour se promener à pied. La neige, de part et d’autre de la route, laissait peu d’espace pour marcher à côté, mais je fus ravie de son apparition. Chaque fois que j’avais le choix entre un être humain, en chair et en os, et un plan, j’optais pour le premier. Alors, carte en main, je me dépêchai d’ouvrir la portière de ma voiture, mais le vent salé qui balayait les champs était plus fort que ce que j’imaginais. Il me vola ma voix. Je dus réessayer. « Excusez-moi… » Je crois que l’épagneul m’entendit en premier. Il se retourna, suivi de son maître. Tous deux revinrent sur leurs pas. L’homme était plus jeune que je ne pensais, à peine plus âgé que moi – la trentaine, peut-être, avec des cheveux noirs ébouriffés par le vent et une barbe de quelques semaines qui lui donnait un petit air de pirate. Il marchait en plastronnant, semblant sûr de lui. « Je peux vous aider ?
— Est-ce que vous pourriez me montrer où nous sommes ? »
Je lui tendis mon plan. Il s’approcha de moi, me contournant pour bloquer le vent, et baissa la tête vers le littoral imprimé. « Ici, annonça-t-il en pointant un cap sans nom. Cruden Bay. Où est-ce que vous êtes censée aller ? » Il tourna très légèrement la tête en me posant cette question, et je vis que ses yeux n’avaient rien de ceux d’un pirate. Ils étaient gris clair et gentils, et sa voix aussi était amicale, avec cette cadence douce caractéristique des Écossais du Nord.
« Je vais vers le nord, à Peterhead.
— Eh bien, ce n’est pas loin. » Il désigna l’endroit du doigt.
« Il vous suffit de rester sur cette route, elle vous emmènera tout droit à Peterhead. » À côté de lui, le chien bâilla, émettant une sorte de plainte, et il soupira en baissant les yeux vers lui. « Une demi-minute. Tu ne vois pas que je suis en train de discuter ? » Je souris. « Comment s’appelle-t-il ?
— Angus. »
Je me penchai pour gratter les oreilles pendantes du chien, éclaboussées de boue. « Bonjour Angus. Tu as pu te dégourdir un peu les pattes ?
— Ah ça, il gambaderait toute la journée si je le laissais faire. Il n’est pas du genre à rester en place. »
Et son maître non plus, pensai-je. Cet homme avait une aura d’énergie, d’agitation, et je l’avais déjà assez retardé. « Je vais vous laisser y aller alors, déclarai-je en me redressant. Merci de votre aide.
— Vraiment pas de quoi », m’assura-t-il avant de tourner les talons, l’épagneul ouvrant joyeusement la voie. Le chemin durci par le gel s’étendait devant eux, vers la mer et, au bout, je voyais les ruines du château, obscures, carrées et dépourvues de toit sous les nuages filant au gré du vent. Tandis que je les regardais, je fus envahie d’une forte envie de rester – de laisser la voiture où je l’avais garée et de suivre l’homme et son chien dans leur promenade, d’entendre le rugissement de
la mer autour de ces murs fragmentés. Mais j’avais des promesses à tenir. Alors, à contrecœur, je remontai dans ma voiture de location, tournai la clé et repartis vers le nord. « Tu as la tête ailleurs. » La voix de Jane, gentiment accusatrice, vint rompre le fil de mes pensées. Nous étions assises dans la chambre à l’étage de sa maison de Peterhead, la chambre au papier peint orné de petites guirlandes
de boutons de rose, à l’écart du vacarme de la réception au rez-de-chaussée. Je rassemblai mes esprits et lui souris. « Absolument pas, je…
— Carolyn McClelland, fi t-elle, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand elle me prenait en flagrant délit de mensonge, je suis ton agent depuis près de sept ans, tu ne peux rien me cacher. Il s’agit du livre ? » Elle me regardait avec des yeux perçants. « Je n’aurais pas dû te traîner ici de la sorte, je me trompe ? Pas alors que tu es en train d’écrire.
— Ne dis pas de bêtises. Il y a des choses plus importantes qu’écrire. » Et pour lui montrer que je le pensais vraiment, je me penchai vers elle pour voir de plus près le bébé endormi sur ses genoux, enveloppé dans une petite couverture. « Il est magnifique.
— N’est-ce pas ? » Toute fi ère, elle suivit mon regard. « La mère d’Alan dit que c’est son portrait. »
Je ne voyais pas cette ressemblance avec son père. « Je trouve qu’il tient plus de toi que de lui. Rien que ses cheveux, regarde moi ça.
— Ah, les cheveux, mon Dieu oui, pauvre bonhomme, dit-elle en caressant la douce petite tête aux mèches blond vénitien.
J’espérais qu’il serait épargné. Il aura sans doute des taches de rousseur, tu sais.
— Mais c’est si mignon, un petit garçon avec des taches de rousseur !
— Oui, eh bien n’hésite pas à venir le lui dire quand il me maudira à l’adolescence.
— Au moins, il ne t’en voudra jamais pour son nom. Jack est un beau prénom, bien viril.
— Le choix du désespoir. J’espérais lui donner un nom plus écossais, mais Alan était si buté… Chaque fois que je proposais quelque chose, il me rétorquait : “Sûrement pas, nous avions un chien qui s’appelait comme ça.” Pour être honnête, Carrie, j’ai cru un moment que nous finirions par le baptiser Bébé Ramsay. »
Mais Jane et Alan trouvaient toujours un terrain d’entente malgré leurs différences, et le petit Jack Ramsay était entré aujourd’hui dans l’Église. Quant à moi, j’étais arrivée juste à temps pour officier en tant que marraine. Le fait que j’aie dû dépasser toutes les limitations de vitesse depuis ma halte à Cruden Bay pour réussir cet exploit avait si peu impressionné le bébé que, lorsqu’il avait posé les yeux sur moi pour la première fois, il avait bâillé et s’était profondément endormi. Il ne s’était même pas réveillé quand le pasteur lui avait aspergé la tête. « Est-il toujours aussi calme ? demandai-je en le contemplant.
— Pourquoi ? Tu ne pensais pas que je pourrais avoir un bébé calme ? » Jane me taquinait, parce qu’elle se connaissait bien. Elle n’était pas ce que j’aurais appelé une personne calme. Dotée d’une volonté de fer, elle était si dynamique, si pleine de vie qu’à ses côtés, j’avais l’impression d’être terne. Et fatiguée. J’étais incapable de suivre le rythme. J’avais été frappée par un virus le mois précédent, ce qui n’aidait pas. J’avais passé Noël au lit et avais raté toutes les réjouissances du Nouvel An. À présent, une semaine après mon rétablissement, je ne me sentais pas encore au meilleur de ma forme. Cependant, même quand j’étais en pleine santé, le niveau d’énergie de Jane était à des kilomètres au-dessus du mien. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle nous travaillions si bien ensemble, pourquoi je l’avais choisie. Je n’étais pas douée avec les éditeurs – je me décourageais trop facilement. Je ne supportais pas le conflit, alors j’avais appris à laisser Jane gérer pour moi cet aspect de mon métier. Elle se battait à ma place, et c’est ainsi qu’à trente et un ans, je me retrouvais avec quatre best-sellers à mon actif, libre de vivre n’importe où et comme bon me semblait.
« Comment est la maison en France ? me demanda-t-elle, revenant de façon inévitable à mon travail. Tu es toujours à Saint-Germain-en-Laye ?
— Parfaite, merci. Et, oui, j’y suis toujours. Ça m’aide à fixer certains détails. Le château de cette ville est au centre de l’intrigue, c’est principalement là que l’action se déroule. » Louis XIV avait en effet offert Saint-Germain comme lieu de refuge aux rois d’Écosse, les Stuart. C’est là qu’ils avaient passé les premières années de leur exil où, tour à tour, le vieux roi Jacques et son fils, Jacques François, consultaient leur cour de fidèles, des partisans qui avaient conspiré avec les nobles d’Écosse pour organiser trois soulèvements jacobites malheureux. Mon histoire était censée tourner autour de Nathaniel Hooke, un Irlandais de Saint-Germain, qui me semblait être le héros parfait pour un roman. Il était né en 1664, un an avant la Grande Peste, et seulement quatre ans après la restauration de la monarchie d’Angleterre avec le couronnement de Charles II. Lorsque le roi Charles était mort et que son frère Jacques, catholique, était monté sur le trône, Hooke avait pris les armes aux côtés des rebelles, mais il avait ensuite abandonné sa foi protestante au profit du catholicisme, changeant de camp et devenant alors l’un des plus farouches défenseurs de Jacques. Mais cela n’avait servi à rien. L’Angleterre était un pays à large majorité protestante, et aucun roi catholique ne pouvait espérer garder sa couronne. La légitimité de Jacques avait ainsi été remise en question par sa propre fille, Marie, et Guillaume d’Orange, son mari. Et cela s’était traduit par une déclaration de guerre. Nathaniel Hooke avait été au cœur de l’action. Il avait combattu pour Jacques en Écosse, et avait été capturé pour espionnage puis emprisonné dans la redoutable Tour de Londres. À sa libération, il avait été prompt à reprendre l’épée pour défendre Jacques et, la guerre finie, quand Guillaume et Marie furent fermement établis sur leur trône et Jacques contraint à l’exil, Hooke l’avait accompagné en France. Mais il n’avait jamais accepté la défaite. Il avait alors utilisé ses nombreux talents pour convaincre son entourage qu’une invasion bien organisée des Écossais soutenue par le roi de France pourrait tout arranger en rendant leur trône aux Stuart exilés. Ils avaient presque réussi. L’histoire se souvenait bien de l’épisode tragique du prince Bonnie Charles à Culloden, des années après Hooke. Mais ce n’était pas au cours de cet hiver glacial à Culloden que les jacobites – littéralement les « adeptes de Jacques », et des Stuart en général – avaient approché la victoire du plus près. Non, c’était au printemps 1708, lorsqu’une flotte d’envahisseurs composée de soldats français et écossais, une idée de Hooke, avait jeté l’ancre dans un estuaire de la côte écossaise, le Firth of Forth. À bord, la vedette était le jeune Jacques Stuart, vingt ans – pas le Jacques qui avait fui l’Angleterre mais son fils, que beaucoup, non seulement en Écosse mais aussi en Angleterre, acceptaient comme leur vrai roi. Sur la rive, des armées de Highlanders et de nobles écossais, restés fidèles, l’attendaient avec impatience pour lutter contre les armées affaiblies plus au sud. De longs mois d’organisation clandestine et de préparations méticuleuses avaient porté leurs fruits et le moment de gloire semblait tout proche, le moment tant attendu où un Stuart réclamerait le trône d’Angleterre. Comment cette grande aventure avait échoué, et pourquoi, était une des histoires les plus fascinantes de la période, une histoire de complot et de traîtrise que tous les camps avaient essayé d’étouffer de leur mieux, saisissant des documents, détruisant des correspondances, répandant rumeurs et désinformation qui avaient toujours été tenues pour véridiques. L’essentiel des faits parvenus jusqu’à nous avaient été rapportés par Nathaniel Hooke. Cet homme me plaisait. J’avais lu ses lettres, j’avais parcouru les grandes salles du château de Saint-Germain-en-Laye où il s’était lui-même promené. Je connaissais les détails de son mariage, de ses enfants, de sa vie relativement longue et de sa mort. J’étais donc frustrée de constater qu’après cinq longs mois de travail, je luttais toujours pour écrire mon roman et que le personnage de Hooke refusait de prendre vie. Jane sentait que j’éprouvais des difficultés – elle me connaissait trop bien et depuis trop longtemps pour ne pas déceler mon état d’esprit. Toutefois, elle savait aussi que je n’aimais pas parler de mes problèmes, alors elle prenait soin de ne pas me poser de questions trop directes. « Au fait, le week-end dernier, j’ai lu les chapitres que tu m’avais envoyés…
— Quand peux-tu bien trouver le temps de lire ?
— On trouve toujours le temps de lire. J’ai donc lu ces chapitres, et je me demandais si tu ne pourrais pas envisager de raconter les événements du point de vue de quelqu’un d’autre… un narrateur, tu sais, comme Fitzgerald le fait avec Nick dans Gatsby le Magnifi que. Je pensais qu’une personne extérieure pourrait peut-être se déplacer plus librement et relier toutes les scènes pour toi. Juste une idée. » Elle en resta là et changea de sujet, sachant que ma première réaction aux conseils de quiconque était souvent une ardente résistance. Presque vingt minutes plus tard, je riais à ses descriptions pince-sans-rire des joies de la maternité, quand son mari, Alan, passa la tête dans l’embrasure de la porte. « Rassurez-moi, vous n’avez pas oublié qu’il y a une réception en bas ? » nous lança-t-il avec un air renfrogné que j’aurais pris bien plus au sérieux si je n’avais pas su que c’était du bluff . Dans le fond, c’était un gentil. « Je ne peux pas distraire tous ces gens tout seul !
— Chéri, répliqua Jane, il s’agit des membres de ta famille.
— Raison de plus pour ne pas me laisser seul avec eux. » Mais il me fi t un clin d’œil. « Elle ne te parle pas boutique, j’espère !
Je lui ai dit de te laisser tranquille. Elle se préoccupe trop des histoires de contrat. » Jane lui rappela que c’était son métier. « Et pour ta gouverne, je ne m’inquiète jamais le moins du monde que Carrie n’honore pas un contrat. En l’occurrence, il lui reste encore sept mois avant la date de remise du premier jet. »
Elle disait cela pour me rassurer, mais Alan dut remarquer mes épaules s’affaisser à ces mots, parce qu’il me tendit la main en disant : « Viens alors. Descends prendre un verre pour me raconter ton périple. Je n’en reviens pas que tu sois arrivée à l’heure en venant de si loin. »
Il y avait déjà assez de plaisanteries récurrentes sur ma tendance à être facilement distraite quand je voyageais, aussi n’évoquai-je pas mon détour près de la côte. Mais une idée me vint alors. « Alan, est-ce que tu pilotes demain ?
— Oui. Pourquoi ? »
La petite fl otte d’hélicoptères d’Alan œuvrait pour les plates-formes pétrolières off-shore parsemées dans la mer du Nord, au large des côtes de Peterhead. C’était un pilote intrépide, comme je l’avais appris la seule et unique fois que j’avais accepté de monter avec lui. Lorsqu’il m’avait ramenée à terre, j’arrivais à peine à tenir debout. Je me retrouvai pourtant à lui dire : « Je me demandais si tu pourrais me faire voir la côte d’en haut. Nathaniel Hooke est venu deux fois de France, pour comploter avec les aristocrates écossais, et chaque fois il a séjourné au château du comte d’Erroll, Slains, qui d’après ma carte devrait être non loin d’ici, au nord. Je souhaiterais voir le château, ou ce qu’il en reste, de la mer, comme il a dû apparaître à Hooke à son arrivée.
— Slains ? Oui, je peux t’y emmener. Mais ce n’est pas au nord, c’est au sud. À Cruden Bay. »
Je le regardai interloquée. « Où ça ?
— Cruden Bay. Tu l’as sans doute raté en venant ici. Ce n’est pas sur la route. »
Jane, toujours attentive, remarqua quelque chose sur mon visage, dans mon expression. « Qu’est-ce qu’il y a ? » me demanda-t-elle. Les heureux hasards ne cessaient jamais de me surprendre
– comment l’imprévu entrait dans ma vie. À voix haute je déclarai seulement : « Rien du tout. Pourrions-nous y aller demain, Alan ?
— Oui. Et je te propose de t’y emmener tôt, comme ça, à notre retour, je garderai Jack un moment et Jane te conduira au château pour que tu te promènes autour. Ça vous fera du bien à toutes les deux de prendre un peu l’air marin. » C’est donc ce que nous fîmes. Ce que j’aperçus des airs paraissait bien plus imposant que ce que j’avais vu à terre – un vaste bâtiment en ruine, dépourvu de toit, qui semblait siéger tout au bord de la falaise, la mer bouillonnant d’écume blanche en contrebas. Je ressentis un léger frisson le long de ma colonne vertébrale et reconnus assez cette sensation familière pour être impatiente de redescendre, pour que Jane me conduise sur les lieux. Cette fois-ci, deux voitures étaient garées sur le parking, et la neige du sentier laissait voir de profondes empreintes. Je partis en avant, levant la tête, offrant mon visage aux bourrasques de vent salé qui me laissaient un petit goût sur les lèvres. Je frissonnai sous les plis chauds de ma veste. Je ne me souviendrais pas, après mon départ, des autres visiteurs, bien que Jane et moi n’étions pas seules. Je ne me souviendrais pas non plus de tellement de détails des ruines elles-mêmes – juste des images… des murs pointus et du granit rouge tacheté de gris qui brillait à la lumière… l’unique tour carrée se dressant, haute et massive, au bord de la falaise… le silence des pièces à l’intérieur, là où le vent cessait de rugir et commençait à pleurer et gémir, et où les poutres nues des anciens plafonds projetaient des ombres sur la neige entassée. Dans une grande pièce, une immense fenêtre, béante, donnait sur la mer et, quand je m’approchai et posai les mains sur le rebord chauffé par le soleil, je remarquai, en bas, les empreintes d’un petit chien, peut-être un épagneul et, à côté, des traces de pas plus profondes indiquant l’endroit où un homme s’était arrêté pour observer, comme moi à présent, l’horizon infini. Je sentais presque sa présence derrière mon épaule, mais dans mon esprit il avait changé. Ce n’était plus l’étranger moderne à qui j’avais parlé la veille, mais quelqu’un d’une époque plus ancienne, un homme portant des bottes, une cape et une épée. Son image devint si réelle que je me retournai… et tombai sur Jane qui me fixait. Elle sourit en voyant l’expression de mon visage. Une expression qu’elle connaissait bien pour avoir été présente de si nombreuses fois au moment où mes personnages commençaient à se mouvoir, à parler et à prendre vie. Elle me proposa d’un air décontracté : « Tu sais que tu peux toujours venir habiter chez nous pour travailler. Nous avons la place. » Je secouai la tête. « Vous avez un bébé. Vous n’avez pas besoin d’avoir en plus un hôte. » Elle me regarda à nouveau, et ce qu’elle vit lui fi t prendre une décision. « Viens alors. Allons te chercher un logement à louer à Cruden Bay. »
Trailer:
Parlons de l'auteur:

Susanna Kearsley est née au Canada. Après avoir été conservatrice de musée, elle décide de se lancer dans l'écriture. Ses romans, tous best-sellers du New York Times, ont été traduits dans 14 pays, sélectionnés pour le club de lecture Mystery Guild, et leurs droits ont été achetés en vue d'une adaptation cinématographique.
Bibliographie:
♦La mer en hiver
Quelques liens indispensables:
♦Site des Editions Charleston
♦Les Editions Charleston sur Facebook
♦Les Editions Charleston sur Twitter
Extrait:
CHAPITRE 1
Ce n’était pas un hasard. Rien de tout cela n’était arrivé par simple hasard.
Je l’appris plus tard ; même si j’eus du mal à accepter cette évidence quand elle me frappa, car j’avais toujours cru fermement à l’autodétermination. Jusque-là, ma vie avait semblé corroborer cette idée – j’avais choisi certaines voies qui m’avaient menée à certaines fi ns, toutes positives, et je considérais
les quelques contretemps rencontrés le long de la route non comme de la malchance, mais comme de simples fruits de mon jugement imparfait. Si j’avais dû choisir un credo, j’aurais opté pour ces deux vers du poète William Henley, vibrants de courage : Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ainsi, lorsque tout commença en ce matin d’hiver, quand j’allai chercher la voiture que j’avais louée et que je quittai Aberdeen pour me diriger vers le nord, l’idée que quelqu’un d’autre puisse être à la barre ne m’effleura pas une seconde. Je croyais sincèrement que m’éloigner de la route principale pour emprunter celle qui longeait la rive découlait de ma propre décision. Sans doute pas la meilleure décision qui soit, d’ailleurs, étant donné que les routes étaient bordées de la neige la plus épaisse qui s’était abattue sur l’Écosse depuis quarante ans, et que l’on m’avait avertie des risques de dérapages et de retards. La prudence et le fait que j’aie un rendez-vous auraient dû m’inciter à rester sur la grand-route, plus sûre, mais le petit panneau indiquant « Route côtière » me fit dévier.
Mon père me disait toujours que j’avais la mer dans le sang. J’étais née et j’avais grandi sur la côte de la Nouvelle-Écosse, et je n’avais jamais pu résister à l’attrait des vagues. Alors, quand la route principale tourna vers l’intérieur des terres, je préférai bifurquer à droite et emprunter la voie côtière.
Je ne pourrais pas dire à quelle distance je me trouvais lorsque j’aperçus sur les falaises le château en ruine, une ligne d’obscurité dentée se détachant sur un ciel nuageux, mais dès l’instant où je le vis, je fus captivée et accélérai. Je ne prêtai aucune attention aux grappes de maisons se dressant sur mon passage et sentis une pointe de déception lorsque la route repartit dans la direction opposée. Mais ensuite, derrière un bois touffu, la route tourna de nouveau et il surgit devant moi : un château sombre abandonné, s’élevant au milieu des champs enneigés qui s’étendaient entre la route et le bord de la falaise, comme pour en interdire l’accès.
Je remarquai un parking un peu plus haut, un petit espace plat jonché de bûches pour délimiter les emplacements et, sans réfléchir, j’allai m’y garer. Il était vide. Pas étonnant, sachant qu’il n’était pas encore midi et que c’était une journée froide et venteuse. En outre, il n’y avait aucune raison de s’arrêter là à moins de vouloir observer les ruines. Et un coup d’œil vers le seul chemin susceptible
d’y mener – un sentier de ferme gelé, couvert de congères plus hautes que mes genoux – me suffit pour deviner qu’il n’y aurait pas foule à y faire escale ce jour-là. Je savais que moi-même je ne devais pas m’arrêter. Je n’en avais pas le temps. Je devais être à Peterhead pour treize heures.
Mais quelque chose en moi ressentait le besoin soudain de savoir exactement où je me trouvais ; je sortis donc mon plan. J’avais passé les cinq mois précédents en France ; c’était là que j’avais acheté ma carte et elle avait ses limites, plus préoccupée par les routes et les autoroutes que par les villages et les ruines. Je scrutais si intensément le gribouillis représentant le littoral, essayant de déchiffrer les noms en petits caractères, que je ne remarquai pas l’homme avant qu’il me dépasse, d’un pas lent, les mains dans les poches, un épagneul aux pattes boueuses sur les talons. Cela me semblait être un endroit étrange pour se promener à pied. La neige, de part et d’autre de la route, laissait peu d’espace pour marcher à côté, mais je fus ravie de son apparition. Chaque fois que j’avais le choix entre un être humain, en chair et en os, et un plan, j’optais pour le premier. Alors, carte en main, je me dépêchai d’ouvrir la portière de ma voiture, mais le vent salé qui balayait les champs était plus fort que ce que j’imaginais. Il me vola ma voix. Je dus réessayer. « Excusez-moi… » Je crois que l’épagneul m’entendit en premier. Il se retourna, suivi de son maître. Tous deux revinrent sur leurs pas. L’homme était plus jeune que je ne pensais, à peine plus âgé que moi – la trentaine, peut-être, avec des cheveux noirs ébouriffés par le vent et une barbe de quelques semaines qui lui donnait un petit air de pirate. Il marchait en plastronnant, semblant sûr de lui. « Je peux vous aider ?
— Est-ce que vous pourriez me montrer où nous sommes ? »
Je lui tendis mon plan. Il s’approcha de moi, me contournant pour bloquer le vent, et baissa la tête vers le littoral imprimé. « Ici, annonça-t-il en pointant un cap sans nom. Cruden Bay. Où est-ce que vous êtes censée aller ? » Il tourna très légèrement la tête en me posant cette question, et je vis que ses yeux n’avaient rien de ceux d’un pirate. Ils étaient gris clair et gentils, et sa voix aussi était amicale, avec cette cadence douce caractéristique des Écossais du Nord.
« Je vais vers le nord, à Peterhead.
— Eh bien, ce n’est pas loin. » Il désigna l’endroit du doigt.
« Il vous suffit de rester sur cette route, elle vous emmènera tout droit à Peterhead. » À côté de lui, le chien bâilla, émettant une sorte de plainte, et il soupira en baissant les yeux vers lui. « Une demi-minute. Tu ne vois pas que je suis en train de discuter ? » Je souris. « Comment s’appelle-t-il ?
— Angus. »
Je me penchai pour gratter les oreilles pendantes du chien, éclaboussées de boue. « Bonjour Angus. Tu as pu te dégourdir un peu les pattes ?
— Ah ça, il gambaderait toute la journée si je le laissais faire. Il n’est pas du genre à rester en place. »
Et son maître non plus, pensai-je. Cet homme avait une aura d’énergie, d’agitation, et je l’avais déjà assez retardé. « Je vais vous laisser y aller alors, déclarai-je en me redressant. Merci de votre aide.
— Vraiment pas de quoi », m’assura-t-il avant de tourner les talons, l’épagneul ouvrant joyeusement la voie. Le chemin durci par le gel s’étendait devant eux, vers la mer et, au bout, je voyais les ruines du château, obscures, carrées et dépourvues de toit sous les nuages filant au gré du vent. Tandis que je les regardais, je fus envahie d’une forte envie de rester – de laisser la voiture où je l’avais garée et de suivre l’homme et son chien dans leur promenade, d’entendre le rugissement de
la mer autour de ces murs fragmentés. Mais j’avais des promesses à tenir. Alors, à contrecœur, je remontai dans ma voiture de location, tournai la clé et repartis vers le nord. « Tu as la tête ailleurs. » La voix de Jane, gentiment accusatrice, vint rompre le fil de mes pensées. Nous étions assises dans la chambre à l’étage de sa maison de Peterhead, la chambre au papier peint orné de petites guirlandes
de boutons de rose, à l’écart du vacarme de la réception au rez-de-chaussée. Je rassemblai mes esprits et lui souris. « Absolument pas, je…
— Carolyn McClelland, fi t-elle, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand elle me prenait en flagrant délit de mensonge, je suis ton agent depuis près de sept ans, tu ne peux rien me cacher. Il s’agit du livre ? » Elle me regardait avec des yeux perçants. « Je n’aurais pas dû te traîner ici de la sorte, je me trompe ? Pas alors que tu es en train d’écrire.
— Ne dis pas de bêtises. Il y a des choses plus importantes qu’écrire. » Et pour lui montrer que je le pensais vraiment, je me penchai vers elle pour voir de plus près le bébé endormi sur ses genoux, enveloppé dans une petite couverture. « Il est magnifique.
— N’est-ce pas ? » Toute fi ère, elle suivit mon regard. « La mère d’Alan dit que c’est son portrait. »
Je ne voyais pas cette ressemblance avec son père. « Je trouve qu’il tient plus de toi que de lui. Rien que ses cheveux, regarde moi ça.
— Ah, les cheveux, mon Dieu oui, pauvre bonhomme, dit-elle en caressant la douce petite tête aux mèches blond vénitien.
J’espérais qu’il serait épargné. Il aura sans doute des taches de rousseur, tu sais.
— Mais c’est si mignon, un petit garçon avec des taches de rousseur !
— Oui, eh bien n’hésite pas à venir le lui dire quand il me maudira à l’adolescence.
— Au moins, il ne t’en voudra jamais pour son nom. Jack est un beau prénom, bien viril.
— Le choix du désespoir. J’espérais lui donner un nom plus écossais, mais Alan était si buté… Chaque fois que je proposais quelque chose, il me rétorquait : “Sûrement pas, nous avions un chien qui s’appelait comme ça.” Pour être honnête, Carrie, j’ai cru un moment que nous finirions par le baptiser Bébé Ramsay. »
Mais Jane et Alan trouvaient toujours un terrain d’entente malgré leurs différences, et le petit Jack Ramsay était entré aujourd’hui dans l’Église. Quant à moi, j’étais arrivée juste à temps pour officier en tant que marraine. Le fait que j’aie dû dépasser toutes les limitations de vitesse depuis ma halte à Cruden Bay pour réussir cet exploit avait si peu impressionné le bébé que, lorsqu’il avait posé les yeux sur moi pour la première fois, il avait bâillé et s’était profondément endormi. Il ne s’était même pas réveillé quand le pasteur lui avait aspergé la tête. « Est-il toujours aussi calme ? demandai-je en le contemplant.
— Pourquoi ? Tu ne pensais pas que je pourrais avoir un bébé calme ? » Jane me taquinait, parce qu’elle se connaissait bien. Elle n’était pas ce que j’aurais appelé une personne calme. Dotée d’une volonté de fer, elle était si dynamique, si pleine de vie qu’à ses côtés, j’avais l’impression d’être terne. Et fatiguée. J’étais incapable de suivre le rythme. J’avais été frappée par un virus le mois précédent, ce qui n’aidait pas. J’avais passé Noël au lit et avais raté toutes les réjouissances du Nouvel An. À présent, une semaine après mon rétablissement, je ne me sentais pas encore au meilleur de ma forme. Cependant, même quand j’étais en pleine santé, le niveau d’énergie de Jane était à des kilomètres au-dessus du mien. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle nous travaillions si bien ensemble, pourquoi je l’avais choisie. Je n’étais pas douée avec les éditeurs – je me décourageais trop facilement. Je ne supportais pas le conflit, alors j’avais appris à laisser Jane gérer pour moi cet aspect de mon métier. Elle se battait à ma place, et c’est ainsi qu’à trente et un ans, je me retrouvais avec quatre best-sellers à mon actif, libre de vivre n’importe où et comme bon me semblait.
« Comment est la maison en France ? me demanda-t-elle, revenant de façon inévitable à mon travail. Tu es toujours à Saint-Germain-en-Laye ?
— Parfaite, merci. Et, oui, j’y suis toujours. Ça m’aide à fixer certains détails. Le château de cette ville est au centre de l’intrigue, c’est principalement là que l’action se déroule. » Louis XIV avait en effet offert Saint-Germain comme lieu de refuge aux rois d’Écosse, les Stuart. C’est là qu’ils avaient passé les premières années de leur exil où, tour à tour, le vieux roi Jacques et son fils, Jacques François, consultaient leur cour de fidèles, des partisans qui avaient conspiré avec les nobles d’Écosse pour organiser trois soulèvements jacobites malheureux. Mon histoire était censée tourner autour de Nathaniel Hooke, un Irlandais de Saint-Germain, qui me semblait être le héros parfait pour un roman. Il était né en 1664, un an avant la Grande Peste, et seulement quatre ans après la restauration de la monarchie d’Angleterre avec le couronnement de Charles II. Lorsque le roi Charles était mort et que son frère Jacques, catholique, était monté sur le trône, Hooke avait pris les armes aux côtés des rebelles, mais il avait ensuite abandonné sa foi protestante au profit du catholicisme, changeant de camp et devenant alors l’un des plus farouches défenseurs de Jacques. Mais cela n’avait servi à rien. L’Angleterre était un pays à large majorité protestante, et aucun roi catholique ne pouvait espérer garder sa couronne. La légitimité de Jacques avait ainsi été remise en question par sa propre fille, Marie, et Guillaume d’Orange, son mari. Et cela s’était traduit par une déclaration de guerre. Nathaniel Hooke avait été au cœur de l’action. Il avait combattu pour Jacques en Écosse, et avait été capturé pour espionnage puis emprisonné dans la redoutable Tour de Londres. À sa libération, il avait été prompt à reprendre l’épée pour défendre Jacques et, la guerre finie, quand Guillaume et Marie furent fermement établis sur leur trône et Jacques contraint à l’exil, Hooke l’avait accompagné en France. Mais il n’avait jamais accepté la défaite. Il avait alors utilisé ses nombreux talents pour convaincre son entourage qu’une invasion bien organisée des Écossais soutenue par le roi de France pourrait tout arranger en rendant leur trône aux Stuart exilés. Ils avaient presque réussi. L’histoire se souvenait bien de l’épisode tragique du prince Bonnie Charles à Culloden, des années après Hooke. Mais ce n’était pas au cours de cet hiver glacial à Culloden que les jacobites – littéralement les « adeptes de Jacques », et des Stuart en général – avaient approché la victoire du plus près. Non, c’était au printemps 1708, lorsqu’une flotte d’envahisseurs composée de soldats français et écossais, une idée de Hooke, avait jeté l’ancre dans un estuaire de la côte écossaise, le Firth of Forth. À bord, la vedette était le jeune Jacques Stuart, vingt ans – pas le Jacques qui avait fui l’Angleterre mais son fils, que beaucoup, non seulement en Écosse mais aussi en Angleterre, acceptaient comme leur vrai roi. Sur la rive, des armées de Highlanders et de nobles écossais, restés fidèles, l’attendaient avec impatience pour lutter contre les armées affaiblies plus au sud. De longs mois d’organisation clandestine et de préparations méticuleuses avaient porté leurs fruits et le moment de gloire semblait tout proche, le moment tant attendu où un Stuart réclamerait le trône d’Angleterre. Comment cette grande aventure avait échoué, et pourquoi, était une des histoires les plus fascinantes de la période, une histoire de complot et de traîtrise que tous les camps avaient essayé d’étouffer de leur mieux, saisissant des documents, détruisant des correspondances, répandant rumeurs et désinformation qui avaient toujours été tenues pour véridiques. L’essentiel des faits parvenus jusqu’à nous avaient été rapportés par Nathaniel Hooke. Cet homme me plaisait. J’avais lu ses lettres, j’avais parcouru les grandes salles du château de Saint-Germain-en-Laye où il s’était lui-même promené. Je connaissais les détails de son mariage, de ses enfants, de sa vie relativement longue et de sa mort. J’étais donc frustrée de constater qu’après cinq longs mois de travail, je luttais toujours pour écrire mon roman et que le personnage de Hooke refusait de prendre vie. Jane sentait que j’éprouvais des difficultés – elle me connaissait trop bien et depuis trop longtemps pour ne pas déceler mon état d’esprit. Toutefois, elle savait aussi que je n’aimais pas parler de mes problèmes, alors elle prenait soin de ne pas me poser de questions trop directes. « Au fait, le week-end dernier, j’ai lu les chapitres que tu m’avais envoyés…
— Quand peux-tu bien trouver le temps de lire ?
— On trouve toujours le temps de lire. J’ai donc lu ces chapitres, et je me demandais si tu ne pourrais pas envisager de raconter les événements du point de vue de quelqu’un d’autre… un narrateur, tu sais, comme Fitzgerald le fait avec Nick dans Gatsby le Magnifi que. Je pensais qu’une personne extérieure pourrait peut-être se déplacer plus librement et relier toutes les scènes pour toi. Juste une idée. » Elle en resta là et changea de sujet, sachant que ma première réaction aux conseils de quiconque était souvent une ardente résistance. Presque vingt minutes plus tard, je riais à ses descriptions pince-sans-rire des joies de la maternité, quand son mari, Alan, passa la tête dans l’embrasure de la porte. « Rassurez-moi, vous n’avez pas oublié qu’il y a une réception en bas ? » nous lança-t-il avec un air renfrogné que j’aurais pris bien plus au sérieux si je n’avais pas su que c’était du bluff . Dans le fond, c’était un gentil. « Je ne peux pas distraire tous ces gens tout seul !
— Chéri, répliqua Jane, il s’agit des membres de ta famille.
— Raison de plus pour ne pas me laisser seul avec eux. » Mais il me fi t un clin d’œil. « Elle ne te parle pas boutique, j’espère !
Je lui ai dit de te laisser tranquille. Elle se préoccupe trop des histoires de contrat. » Jane lui rappela que c’était son métier. « Et pour ta gouverne, je ne m’inquiète jamais le moins du monde que Carrie n’honore pas un contrat. En l’occurrence, il lui reste encore sept mois avant la date de remise du premier jet. »
Elle disait cela pour me rassurer, mais Alan dut remarquer mes épaules s’affaisser à ces mots, parce qu’il me tendit la main en disant : « Viens alors. Descends prendre un verre pour me raconter ton périple. Je n’en reviens pas que tu sois arrivée à l’heure en venant de si loin. »
Il y avait déjà assez de plaisanteries récurrentes sur ma tendance à être facilement distraite quand je voyageais, aussi n’évoquai-je pas mon détour près de la côte. Mais une idée me vint alors. « Alan, est-ce que tu pilotes demain ?
— Oui. Pourquoi ? »
La petite fl otte d’hélicoptères d’Alan œuvrait pour les plates-formes pétrolières off-shore parsemées dans la mer du Nord, au large des côtes de Peterhead. C’était un pilote intrépide, comme je l’avais appris la seule et unique fois que j’avais accepté de monter avec lui. Lorsqu’il m’avait ramenée à terre, j’arrivais à peine à tenir debout. Je me retrouvai pourtant à lui dire : « Je me demandais si tu pourrais me faire voir la côte d’en haut. Nathaniel Hooke est venu deux fois de France, pour comploter avec les aristocrates écossais, et chaque fois il a séjourné au château du comte d’Erroll, Slains, qui d’après ma carte devrait être non loin d’ici, au nord. Je souhaiterais voir le château, ou ce qu’il en reste, de la mer, comme il a dû apparaître à Hooke à son arrivée.
— Slains ? Oui, je peux t’y emmener. Mais ce n’est pas au nord, c’est au sud. À Cruden Bay. »
Je le regardai interloquée. « Où ça ?
— Cruden Bay. Tu l’as sans doute raté en venant ici. Ce n’est pas sur la route. »
Jane, toujours attentive, remarqua quelque chose sur mon visage, dans mon expression. « Qu’est-ce qu’il y a ? » me demanda-t-elle. Les heureux hasards ne cessaient jamais de me surprendre
– comment l’imprévu entrait dans ma vie. À voix haute je déclarai seulement : « Rien du tout. Pourrions-nous y aller demain, Alan ?
— Oui. Et je te propose de t’y emmener tôt, comme ça, à notre retour, je garderai Jack un moment et Jane te conduira au château pour que tu te promènes autour. Ça vous fera du bien à toutes les deux de prendre un peu l’air marin. » C’est donc ce que nous fîmes. Ce que j’aperçus des airs paraissait bien plus imposant que ce que j’avais vu à terre – un vaste bâtiment en ruine, dépourvu de toit, qui semblait siéger tout au bord de la falaise, la mer bouillonnant d’écume blanche en contrebas. Je ressentis un léger frisson le long de ma colonne vertébrale et reconnus assez cette sensation familière pour être impatiente de redescendre, pour que Jane me conduise sur les lieux. Cette fois-ci, deux voitures étaient garées sur le parking, et la neige du sentier laissait voir de profondes empreintes. Je partis en avant, levant la tête, offrant mon visage aux bourrasques de vent salé qui me laissaient un petit goût sur les lèvres. Je frissonnai sous les plis chauds de ma veste. Je ne me souviendrais pas, après mon départ, des autres visiteurs, bien que Jane et moi n’étions pas seules. Je ne me souviendrais pas non plus de tellement de détails des ruines elles-mêmes – juste des images… des murs pointus et du granit rouge tacheté de gris qui brillait à la lumière… l’unique tour carrée se dressant, haute et massive, au bord de la falaise… le silence des pièces à l’intérieur, là où le vent cessait de rugir et commençait à pleurer et gémir, et où les poutres nues des anciens plafonds projetaient des ombres sur la neige entassée. Dans une grande pièce, une immense fenêtre, béante, donnait sur la mer et, quand je m’approchai et posai les mains sur le rebord chauffé par le soleil, je remarquai, en bas, les empreintes d’un petit chien, peut-être un épagneul et, à côté, des traces de pas plus profondes indiquant l’endroit où un homme s’était arrêté pour observer, comme moi à présent, l’horizon infini. Je sentais presque sa présence derrière mon épaule, mais dans mon esprit il avait changé. Ce n’était plus l’étranger moderne à qui j’avais parlé la veille, mais quelqu’un d’une époque plus ancienne, un homme portant des bottes, une cape et une épée. Son image devint si réelle que je me retournai… et tombai sur Jane qui me fixait. Elle sourit en voyant l’expression de mon visage. Une expression qu’elle connaissait bien pour avoir été présente de si nombreuses fois au moment où mes personnages commençaient à se mouvoir, à parler et à prendre vie. Elle me proposa d’un air décontracté : « Tu sais que tu peux toujours venir habiter chez nous pour travailler. Nous avons la place. » Je secouai la tête. « Vous avez un bébé. Vous n’avez pas besoin d’avoir en plus un hôte. » Elle me regarda à nouveau, et ce qu’elle vit lui fi t prendre une décision. « Viens alors. Allons te chercher un logement à louer à Cruden Bay. »
Trailer:
Parlons de l'auteur:

Susanna Kearsley est née au Canada. Après avoir été conservatrice de musée, elle décide de se lancer dans l'écriture. Ses romans, tous best-sellers du New York Times, ont été traduits dans 14 pays, sélectionnés pour le club de lecture Mystery Guild, et leurs droits ont été achetés en vue d'une adaptation cinématographique.
Bibliographie:
♦La mer en hiver
Quelques liens indispensables:
♦Site des Editions Charleston
♦Les Editions Charleston sur Facebook
♦Les Editions Charleston sur Twitter