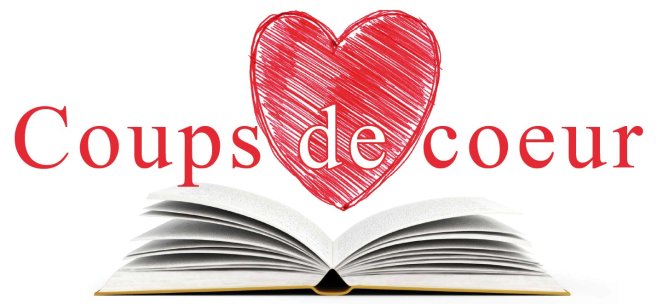Genre: Historique
Nombre de pages: 143
Date de sortie: 19/09/2013
Prix support papier: 6€60
Prix format numérique: 9€99
ISBN: 978-2264060532
Editions: 10/18
Acheter ce livre - Papier
Acheter ce livre - Numérique
Synopsis:
Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux États-Unis, toutes mariées par procuration.
C'est après une éprouvante traversée de l'Océan pacifique qu'elles rencontrent pour la première fois à San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir.
À la façon d'un chœur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées... leurs nuits de noces, souvent brutales, leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats pour apprivoiser une langue inconnue, la naissance de leurs enfants, l'humiliation des Blancs... Une véritable clameur jusqu'au silence de la guerre et la détention dans les camps d' internement – l'État considère tout Japonais vivant en Amérique comme traître. Bientôt, l'oubli emporte tout, comme si elles, leurs époux et leurs progénitures n'avaient jamais existé.
Tu verras : les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes.
|
Mon avis:
Un avis mitigé.
Je n'ai pas apprécié le style de l'auteur, mais j'ai trouvé les histoires de ces femmes touchantes.
Une lecture qui m'a quand même déçue dans son ensemble.
Informations:
Ce récit contient plusieurs chapitres non numérotés.
C'est un roman qui se lit assez vite, il n'est pas très épais, à peine 150 pages.
Ce récit contient plusieurs chapitres non numérotés.
C'est un roman qui se lit assez vite, il n'est pas très épais, à peine 150 pages.
Mes ressentis:
Un titre qui a attisé ma curiosité "Certaines n'avaient jamais vu la mer" laisse sous-entendre que ce récit ne va pas être une lecture détente, mais quelque chose d'un peu plus profond et sensible. Quant à la couverture, je la trouve très jolie, elle m'a, elle aussi mise en confiance et donnée envie de découvrir le contenu de ce roman. J'ai eu l'occasion de trouver ce livre en troc et je n'ai pas hésité une seconde avant de me le procurer. Je pensais sincèrement qu'il correspondait à mon style de lecture et que j'allais être particulièrement touchée, mais non.
L'histoire commence en 1919, nous suivons le destin de femmes qui rejoignent les États-Unis afin de retrouver leur mari avec qui elles ont été unis par obligation. La suite, c'est simple, c'est un enchaînement de choses négatives et difficiles. C'est un récit fort et consternant qui est mis en place et ce, dès les premières lignes. J'ai trouvé cette lecture très particulière et pénible, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, à m’intéresser à ces femmes qui pourtant ne laissent pas indifférentes.
Le style de l'auteur y est pour beaucoup dans mon avis mitigé, il m'a complètement rebutée malgré la poésie que j'ai pu relever dans certains passages. Julie Otsuka parle de toutes ces femmes en même temps, c'est déconcertant et puis, c'est un ensemble qui n'est pas très engageant, parfois même lassant. C'est un livre qui se lit rapidement, en quelques heures, mais difficilement. Je ne suis pas une grande adepte de ce genre de lecture. Je sais que je fais partie des minoritaires et tant mieux, mais chez moi, ce roman n'a pas eu l'effet escompté. Dommage !
Un titre qui a attisé ma curiosité "Certaines n'avaient jamais vu la mer" laisse sous-entendre que ce récit ne va pas être une lecture détente, mais quelque chose d'un peu plus profond et sensible. Quant à la couverture, je la trouve très jolie, elle m'a, elle aussi mise en confiance et donnée envie de découvrir le contenu de ce roman. J'ai eu l'occasion de trouver ce livre en troc et je n'ai pas hésité une seconde avant de me le procurer. Je pensais sincèrement qu'il correspondait à mon style de lecture et que j'allais être particulièrement touchée, mais non.
L'histoire commence en 1919, nous suivons le destin de femmes qui rejoignent les États-Unis afin de retrouver leur mari avec qui elles ont été unis par obligation. La suite, c'est simple, c'est un enchaînement de choses négatives et difficiles. C'est un récit fort et consternant qui est mis en place et ce, dès les premières lignes. J'ai trouvé cette lecture très particulière et pénible, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, à m’intéresser à ces femmes qui pourtant ne laissent pas indifférentes.
Le style de l'auteur y est pour beaucoup dans mon avis mitigé, il m'a complètement rebutée malgré la poésie que j'ai pu relever dans certains passages. Julie Otsuka parle de toutes ces femmes en même temps, c'est déconcertant et puis, c'est un ensemble qui n'est pas très engageant, parfois même lassant. C'est un livre qui se lit rapidement, en quelques heures, mais difficilement. Je ne suis pas une grande adepte de ce genre de lecture. Je sais que je fais partie des minoritaires et tant mieux, mais chez moi, ce roman n'a pas eu l'effet escompté. Dommage !
Pour conclure:
Un roman qui m'a laissée sur la touche et pourtant le contenu y est. C'est intéressant, mais très poignant, peut-être trop.
Si j'ai été sensible à toutes ces histoires, je n'ai pas été touchée par le style de l'auteur. Je n'ai pas aimé sa façon de parler de toutes ces femmes en même temps. Je ne me suis attachée à aucune d'elles et c'est très important pour moi de me lier à quelques personnages afin de ressentir de l'empathie.
J'aurais aimé vous parler de ce roman différemment, mais je suis passée à côté de ce récit.
Un roman qui m'a laissée sur la touche et pourtant le contenu y est. C'est intéressant, mais très poignant, peut-être trop.
Si j'ai été sensible à toutes ces histoires, je n'ai pas été touchée par le style de l'auteur. Je n'ai pas aimé sa façon de parler de toutes ces femmes en même temps. Je ne me suis attachée à aucune d'elles et c'est très important pour moi de me lier à quelques personnages afin de ressentir de l'empathie.
J'aurais aimé vous parler de ce roman différemment, mais je suis passée à côté de ce récit.
*Angélique*
Extrait:
BIENVENUE, MESDEMOISELLES JAPONAISES !
Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées, certaines n'avaient que quatorze ans et c'étaient encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté - hérité de nos soeurs, passé, rapiécé, et bien des fois reteint. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en image, certaines étaient filles de pêcheur et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l'océan nous avait pris un frère, un père, ou un fiancé, parfois une personne que nous aimions s'était jetée à l'eau par un triste matin pour nager vers le large, et il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour.
Sur le bateau, la première chose que nous avons faite - avant de décider qui nous aimerions et qui nous n'aimerions pas, avant de nous dire les unes aux autres de quelle île nous venions et pourquoi nous la quittions, avant même de prendre la peine de faire les présentations -, c'est comparer les portraits de nos fiancés. C'étaient de beaux jeunes gens aux yeux sombres, à la chevelure touffue, à la peau lisse et sans défaut. Au menton affirmé. Au nez haut et droit. A la posture impeccable. Ils ressemblaient à nos frères, à nos pères restés là-bas, mais en mieux habillés, avec leurs redingotes grises et leurs élégants costumes trois-pièces à l'occidentale. Certains d'entre eux étaient photographiés sur le trottoir, devant une maison en bois au toit pointu, à la pelouse impeccable, enclose derrière une barrière de piquets blancs, d'autres dans l'allée du garage, appuyés contre une Ford T. Certains avaient posé dans un studio sur une chaise au dossier haut, les mains croisées avec soin, regard braqué sur l'objectif, comme s'ils étaient prêts à conquérir le monde. Tous avaient promis de nous attendre à San Francisco, à notre arrivée au port.
Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions- nous d'après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ?
Sur le bateau nous dormions en bas, à l'entrepont, espace noir et crasseux. Nos lits consistaient en d'étroites couchettes de métal empilées les unes sur les autres, aux rudes matelas trop fins, jaunis par les taches d'autres voyages, d'autres vies. Nos oreillers étaient garnis de paille séchée. Entre les couchettes, des miettes de nourriture jonchaient le sol, humide et glissant. Il y avait un hublot et, le soir, lorsqu'il était fermé, l'obscurité s'emplissait de murmures. Est-ce que ça va faire mal ? Les corps se tournaient et se retournaient sous les couvertures. La mer s'élevait, s'abaissait. L'atmosphère humide était suffocante. La nuit nous rêvions de nos maris. De nouvelles sandales de bois, d'infinis rouleaux de soie indigo, de vivre dans une maison avec une cheminée. Nous rêvions que nous étions grandes et belles. Que nous étions de retour dans les rizières que nous voulions si désespérément fuir. Ces rêves de rizières étaient toujours des cauchemars. Nous rêvions aussi de nos soeurs, plus âgées, plus jolies, que nos pères avaient vendues comme geishas pour nourrir le reste de la famille, et nous nous réveillions en suffoquant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais à sa place.
Les premiers jours sur le bateau nous étions malades, notre estomac ne gardait rien, et nous étions sans cesse obligées de courir jusqu'au bastingage. Certaines d'entre nous étaient prises de vertiges, au point de ne plus pouvoir se lever, et demeuraient sur leur couchette dans une morne torpeur, incapables de se souvenir de leur nom sans parler de celui de leur futur mari. Rappelle-moi encore une fois, je suis Mrs Qui, déjà ? Certaines se tenaient le ventre et priaient à haute voix Kannon, la déesse de la miséricorde - Où es-tu ? - tandis que d'autres préféraient verdir en silence. Souvent au beau milieu de la nuit nous étions réveillées par le mouvement violent de la houle, et l'espace d'un instant nous ne savions plus où nous étions, pourquoi nos lits ne cessaient de bouger, ni pourquoi nos coeurs cognaient si fort d'effroi.
Tremblement de terre, voilà la première pensée qui nous venait. Alors nous cherchions notre mère car nous avions de tout temps dormi entre ses bras. Dormait-elle en ce moment ? Rêvait-elle ? Songeait-elle à nous nuit et jour ? Marchait-elle toujours trois pas derrière notre père dans la rue, les bras chargés de paquets, alors que lui ne portait rien du tout ? Nous enviait-elle en secret d'être partie ? Est-ce que je ne t'ai pas tout donné ? Pensait-elle à aérer nos vieux kimonos ? A donner à manger au chat ? Nous avait-elle bien appris tout ce dont nous avions besoin ? Tiens ton bol à deux mains, ne reste pas au soleil, ne parle jamais plus qu'il ne faut.
Sur le bateau nous étions dans l'ensemble des jeunes filles accomplies, persuadées que nous ferions de bonnes épouses. Nous savions coudre et cuisiner. Servir le thé, disposer des fleurs et rester assises sans bouger sur nos grands pieds pendant des heures en ne disant absolument rien d'important. Une jeune fille doit se fondre dans le décor : elle doit être là sans qu'on la remarque. Nous savions nous comporter lors des enterrements, écrire de courts poèmes mélancoliques sur l'arrivée de l'automne comptant exactement dix-sept syllabes. Nous savions désherber, couper du petit bois, tirer l'eau du puits, et l'une d'entre nous - la fille du meunier - était capable de parcourir les trois kilomètres jusqu'à la ville en portant sur son dos un sac de trente-cinq kilos de riz sans jamais transpirer. Tout est dans la façon dont on respire. Nous avions pour la plupart de bonnes manières et nous étions d'une extrême politesse, sauf quand nous explosions de colère et nous mettions à jurer comme des marins. Pour la plupart nous parlions comme des dames, d'une voix haut perchée en feignant d'en savoir bien moins qu'en réalité, et chaque fois que nous passions sur le pont nous prenions garde d'avancer à petits pas, en rentrant les orteils comme il convient. Car combien de fois notre mère nous avait-elle répété : Marche comme si tu étais en ville, pas à la ferme !
Sur le bateau chaque nuit nous nous pressions dans le lit les unes des autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions. Les gens là-bas, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils (nous étions bouddhistes pour la plupart donc nous ne mangions pas de viande et nous n'avions de poil qu'aux endroits appropriés). Les arbres étaient énormes. Les plaines, immenses. Les femmes, bruyantes et grandes - une bonne tête de plus, avions-nous appris, que les plus grands de nos hommes. Leur langue était dix fois plus compliquée que la nôtre et les coutumes incroyablement étranges. Les livres se lisaient de la fin vers le début et on utilisait du savon au bain. On se mouchait dans des morceaux de tissu crasseux que l'on repliait ensuite pour les ranger dans une poche, afin de les utiliser encore et encore. Le contraire du blanc n'était pas le rouge mais le noir. Qu'allions-nous devenir, nous demandions-nous, dans un pays aussi différent ? Nous nous voyions - peuple de petite taille, armé de ses seuls livres - débarquer au pays des géants. Se moquerait-on de nous ? Nous cracherait-on dessus ? Nous prendrait-on seulement au sérieux ? Toutefois, même les plus réticentes admettaient qu'il valait mieux épouser un inconnu en Amérique que de vieillir auprès d'un fermier du village. Car en Amérique les filles ne travaillaient pas aux champs, il y avait plein de riz et de bois de chauffage pour tout le monde. Et partout où l'on allait, les hommes tenaient la porte aux femmes et soulevaient leur chapeau en disant : "Les dames d'abord" et "Après vous".
Sur le bateau certaines d'entre nous venaient de Kyoto, elles étaient blanches et délicates car elles avaient passé leur vie dans des pièces sombres, au fond des maisons. Certaines venaient de Nara, elles priaient leurs ancêtres trois fois par jour et juraient entendre encore sonner les cloches du temple. Certaines étaient filles de paysans de la région de Yamaguchi, elles avaient les épaules larges, les poignets épais et ne s'étaient jamais couchées au-delà de neuf heures du soir. Certaines étaient issues d'un petit village de montagne de Yamanashi et avaient découvert le chemin de fer il y a peu. Certaines venaient de Tokyo, elles avaient tout vu, parlaient un japonais très beau et ne se mêlaient guère aux autres. Beaucoup étaient de Kagoshima et baragouinaient un rude patois du Sud, que celles de Tokyo feignaient de ne pas comprendre. D'autres étaient d'Hokkaido, au climat froid et enneigé, et pendant des années elles rêveraient de ces paysages blancs. Celles qui venaient d'Hiroshima, où la bombe exploserait, avaient de la chance d'être sur ce bateau, bien qu'à l'époque nul n'en sache rien. La plus jeune d'entre nous avait douze ans et n'avait pas encore ses règles. Mes parents m'ont mariée pour avoir l'argent de la dot. La plus âgée, trente-sept ans, était de Niigata et avait passé sa vie à s'occuper de son père, un invalide dont la mort récente la rendait à la fois heureuse et triste. Je savais que je ne pourrais me marier que s'il mourait. L'une des nôtres venait de Kumamoto, où il n'y avait plus d'hommes valides - ils étaient tous partis l'année précédente chercher du travail en Mandchourie -, et s'estimait heureuse d'avoir trouvé un mari, quel qu'il soit. J'ai regardé son portrait et j'ai dit à la marieuse : "Ça fera l'affaire." Une autre était issue d'un village dans la région de Fukushima où l'on tissait la soie, son premier mari était mort de la grippe, le deuxième l'avait quittée pour une femme plus jeune et plus jolie qui habitait sur l'autre versant de la colline et, à présent, elle partait pour l'Amérique afin d'épouser le troisième. Il est en bonne santé, il ne boit pas, il ne joue pas, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. L'une d'entre nous avait été danseuse à Nagoya, elle était très élégante, avait une peau d'un blanc translucide et savait tout sur les hommes, aussi était-ce vers elle que chaque soir nous nous tournions pour lui poser nos questions. Combien de temps cela va-t-il durer ? Avec la lumière allumée ou dans le noir ? Les jambes en l'air ou posées ? Les yeux ouverts ou fermés ? Et si je ne peux pas respirer ? Et si j'ai soif ? Et s'il est trop lourd ? Trop gros ? Et s'il ne veut pas de moi ? "En vérité, les hommes sont très simples", répondait-elle. Puis elle se mettait à nous expliquer.
Sur le bateau parfois nous restions éveillées pendant des heures dans l'obscurité sombre et humide de la cale, remplies de désirs et de peurs, nous demandant com- ment nous tiendrions encore trois semaines.
Sur le bateau nous avions emporté dans nos malles tout ce dont nous aurions besoin dans notre nouvelle vie : un kimono de soie blanche pour notre nuit de noces, d'autres en coton coloré pour tous les jours, de plus discrets pour quand nous serions vieilles, et puis des pinceaux à calligraphie, d'épais bâtons d'encre noire, de fines feuilles de papier de riz afin d'écrire de longues lettres à notre famille, un minuscule bouddha de cuivre, une statuette d'ivoire représentant le dieu renard, la poupée avec laquelle nous dormions depuis que nous avions cinq ans, des sachets de sucre roux pour nous acheter des passe-droits, des couvertures éclatantes, des éventails de papier, des livres comportant des phrases en anglais, de petits sacs de soie imprimée de fleurs, des galets noirs polis par la rivière qui coulait derrière notre maison, une mèche de cheveux d'un garçon que nous avions un jour touché, aimé, à qui nous avions promis d'écrire, tout en sachant que nous ne le ferions jamais, le miroir d'argent donné par notre mère, dont les dernières paroles résonnaient encore à notre oreille. Tu verras : les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes.
Sur le bateau nous nous plaignions de tout. Des puces. De l'insomnie. Des punaises de lit. Du monotone ronron perpétuel du moteur qui nous poursuivait jusque dans nos rêves. Nous nous plaignions de la puanteur des latrines - énormes trous béants s'ouvrant sur la mer - et de notre propre odeur qui lentement mûrissait et devenait jour après jour de plus en plus fétide. Nous nous plaignions de la condescendance de Kazuko, de Chiyo qui se raclait sans cesse la gorge, de Fusayo qui fredonnait toujours La Chanson du cueilleur de thé, ce qui peu à peu nous rendait folles. Nous nous plaignions de nos épingles à cheveux qui disparaissaient - qui parmi nous était la voleuse ? - et du fait que les filles voyageant en première classe ne nous avaient jamais saluées depuis le pont supérieur, du haut de leur parasol de soie violette, malgré le nombre de fois où elles nous avaient croisées. Mais pour qui se prennent-elles, celles-là ? Nous nous plaignions de la chaleur. Nous nous plaignions du froid. Des couvertures de laine qui grattaient. De nos propres jérémiades. Au fond, pourtant, nous étions très heureuses pour la plupart d'entre nous, car bientôt, nous serions en Amérique avec nos futurs maris, qui nous avaient écrit bien des fois au cours des mois précédents. J'ai acheté une belle maison. Vous pourrez planter des tulipes dans le jardin. Des jonquilles. Ce que vous voudrez. Je possède une ferme. Je dirige un hôtel. Je suis président d'une grosse banque. J'ai quitté le Japon il y a des années pour fonder ma propre entreprise et je peux largement subvenir à vos besoins. Je mesure un mètre soixante-dix-neuf, je n'ai ni la lèpre ni de maladie des poumons, et il n'y a pas de fous dans ma famille. Je suis originaire d'Okayama. De Hyogo. Miyagi. Shizuoka. J'ai grandi dans le village voisin du vôtre et je vous ai vue il y a des années dans une foire. Je vous enverrai l'argent pour payer votre passage dès que possible.
Sur le bateau nous conservions la photographie de notre époux dans un minuscule médaillon ovale suspendu à notre cou au bout d'une longue chaîne. Nous la gardions dans une bourse de soie, une vieille boîte à thé, un coffret de laque rouge, dans la grosse enveloppe marron qui nous l'avait apportée d'Amérique. Nous la transportions dans les manches de notre kimono et souvent nous la touchions à travers le tissu pour nous assurer qu'elle était bien là. Nous l'emportions serrée entre les pages de Bienvenue, mesdemoiselles japonaises !, du Guide pour se rendre en Amérique, de Dix façons de faire plaisir à un homme, d'un vieux volume usagé de sutras bouddhistes, et l'une des nôtres, qui était chrétienne, mangeait de la viande et priait un dieu différent aux longs cheveux, l'avait rangée entre les pages de la bible du roi Jacques. Et quand nous lui demandions lequel elle préférait - l'homme de la photo ou le Seigneur Jésus lui-même -, elle nous adressait un sourire mystérieux et répondait : "Lui, bien sûr."
Sur le bateau plusieurs d'entre nous emportaient des secrets qu'elles se juraient de ne jamais révéler à leur mari. Peut-être qu'en réalité nous avions résolu d'aller en Amérique pour retrouver un père qui avait abandonné sa famille très longtemps auparavant. Il est parti travailler dans les mines de charbon du Wyoming et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Ou peut-être laissions-nous une fille, engendrée par un homme dont nous nous rappelions avec peine le visage - un conteur itinérant qui avait passé une semaine dans notre village, un prêtre bouddhiste errant qui s'était arrêté un soir tard chez nous, sur la route du mont Fuji. Nous avions beau savoir que nos parents s'occuperaient bien d'elle - Si tu restes ici, au village, nous avaient-ils prévenues, tu ne trouveras jamais de mari -, nous nous sentions coupables d'avoir choisi de privilégier notre vie aux dépens de la sienne et, durant le voyage, pendant bien des nuits nous avons pleuré en pensant à elle, jusqu'au matin où nous nous sommes réveillées en décrétant : "Ça suffit", et nous nous sommes mises à penser à autre chose. Au kimono que nous porterions le jour de notre arrivée. A notre coiffure. A ce que nous dirions quand nous le verrions. Parce qu'à présent nous étions sur le bateau, le passé était derrière nous et il n'y avait pas de retour possible.
Sur le bateau nous ne pouvions savoir que nous rêve- rions d'elle toutes les nuits jusqu'au jour de notre mort, que dans nos songes elle aurait toujours trois ans et demeurerait telle que nous l'avions vue en la quittant : une minuscule silhouette vêtue d'un kimono rouge sombre, accroupie au bord d'une flaque, totalement captivée par la vue d'une abeille morte flottant à la surface.
Interview de Julie Otsuka:
BIENVENUE, MESDEMOISELLES JAPONAISES !
Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées, certaines n'avaient que quatorze ans et c'étaient encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté - hérité de nos soeurs, passé, rapiécé, et bien des fois reteint. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en image, certaines étaient filles de pêcheur et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l'océan nous avait pris un frère, un père, ou un fiancé, parfois une personne que nous aimions s'était jetée à l'eau par un triste matin pour nager vers le large, et il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour.
Sur le bateau, la première chose que nous avons faite - avant de décider qui nous aimerions et qui nous n'aimerions pas, avant de nous dire les unes aux autres de quelle île nous venions et pourquoi nous la quittions, avant même de prendre la peine de faire les présentations -, c'est comparer les portraits de nos fiancés. C'étaient de beaux jeunes gens aux yeux sombres, à la chevelure touffue, à la peau lisse et sans défaut. Au menton affirmé. Au nez haut et droit. A la posture impeccable. Ils ressemblaient à nos frères, à nos pères restés là-bas, mais en mieux habillés, avec leurs redingotes grises et leurs élégants costumes trois-pièces à l'occidentale. Certains d'entre eux étaient photographiés sur le trottoir, devant une maison en bois au toit pointu, à la pelouse impeccable, enclose derrière une barrière de piquets blancs, d'autres dans l'allée du garage, appuyés contre une Ford T. Certains avaient posé dans un studio sur une chaise au dossier haut, les mains croisées avec soin, regard braqué sur l'objectif, comme s'ils étaient prêts à conquérir le monde. Tous avaient promis de nous attendre à San Francisco, à notre arrivée au port.
Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions- nous d'après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ?
Sur le bateau nous dormions en bas, à l'entrepont, espace noir et crasseux. Nos lits consistaient en d'étroites couchettes de métal empilées les unes sur les autres, aux rudes matelas trop fins, jaunis par les taches d'autres voyages, d'autres vies. Nos oreillers étaient garnis de paille séchée. Entre les couchettes, des miettes de nourriture jonchaient le sol, humide et glissant. Il y avait un hublot et, le soir, lorsqu'il était fermé, l'obscurité s'emplissait de murmures. Est-ce que ça va faire mal ? Les corps se tournaient et se retournaient sous les couvertures. La mer s'élevait, s'abaissait. L'atmosphère humide était suffocante. La nuit nous rêvions de nos maris. De nouvelles sandales de bois, d'infinis rouleaux de soie indigo, de vivre dans une maison avec une cheminée. Nous rêvions que nous étions grandes et belles. Que nous étions de retour dans les rizières que nous voulions si désespérément fuir. Ces rêves de rizières étaient toujours des cauchemars. Nous rêvions aussi de nos soeurs, plus âgées, plus jolies, que nos pères avaient vendues comme geishas pour nourrir le reste de la famille, et nous nous réveillions en suffoquant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais à sa place.
Les premiers jours sur le bateau nous étions malades, notre estomac ne gardait rien, et nous étions sans cesse obligées de courir jusqu'au bastingage. Certaines d'entre nous étaient prises de vertiges, au point de ne plus pouvoir se lever, et demeuraient sur leur couchette dans une morne torpeur, incapables de se souvenir de leur nom sans parler de celui de leur futur mari. Rappelle-moi encore une fois, je suis Mrs Qui, déjà ? Certaines se tenaient le ventre et priaient à haute voix Kannon, la déesse de la miséricorde - Où es-tu ? - tandis que d'autres préféraient verdir en silence. Souvent au beau milieu de la nuit nous étions réveillées par le mouvement violent de la houle, et l'espace d'un instant nous ne savions plus où nous étions, pourquoi nos lits ne cessaient de bouger, ni pourquoi nos coeurs cognaient si fort d'effroi.
Tremblement de terre, voilà la première pensée qui nous venait. Alors nous cherchions notre mère car nous avions de tout temps dormi entre ses bras. Dormait-elle en ce moment ? Rêvait-elle ? Songeait-elle à nous nuit et jour ? Marchait-elle toujours trois pas derrière notre père dans la rue, les bras chargés de paquets, alors que lui ne portait rien du tout ? Nous enviait-elle en secret d'être partie ? Est-ce que je ne t'ai pas tout donné ? Pensait-elle à aérer nos vieux kimonos ? A donner à manger au chat ? Nous avait-elle bien appris tout ce dont nous avions besoin ? Tiens ton bol à deux mains, ne reste pas au soleil, ne parle jamais plus qu'il ne faut.
Sur le bateau nous étions dans l'ensemble des jeunes filles accomplies, persuadées que nous ferions de bonnes épouses. Nous savions coudre et cuisiner. Servir le thé, disposer des fleurs et rester assises sans bouger sur nos grands pieds pendant des heures en ne disant absolument rien d'important. Une jeune fille doit se fondre dans le décor : elle doit être là sans qu'on la remarque. Nous savions nous comporter lors des enterrements, écrire de courts poèmes mélancoliques sur l'arrivée de l'automne comptant exactement dix-sept syllabes. Nous savions désherber, couper du petit bois, tirer l'eau du puits, et l'une d'entre nous - la fille du meunier - était capable de parcourir les trois kilomètres jusqu'à la ville en portant sur son dos un sac de trente-cinq kilos de riz sans jamais transpirer. Tout est dans la façon dont on respire. Nous avions pour la plupart de bonnes manières et nous étions d'une extrême politesse, sauf quand nous explosions de colère et nous mettions à jurer comme des marins. Pour la plupart nous parlions comme des dames, d'une voix haut perchée en feignant d'en savoir bien moins qu'en réalité, et chaque fois que nous passions sur le pont nous prenions garde d'avancer à petits pas, en rentrant les orteils comme il convient. Car combien de fois notre mère nous avait-elle répété : Marche comme si tu étais en ville, pas à la ferme !
Sur le bateau chaque nuit nous nous pressions dans le lit les unes des autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions. Les gens là-bas, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils (nous étions bouddhistes pour la plupart donc nous ne mangions pas de viande et nous n'avions de poil qu'aux endroits appropriés). Les arbres étaient énormes. Les plaines, immenses. Les femmes, bruyantes et grandes - une bonne tête de plus, avions-nous appris, que les plus grands de nos hommes. Leur langue était dix fois plus compliquée que la nôtre et les coutumes incroyablement étranges. Les livres se lisaient de la fin vers le début et on utilisait du savon au bain. On se mouchait dans des morceaux de tissu crasseux que l'on repliait ensuite pour les ranger dans une poche, afin de les utiliser encore et encore. Le contraire du blanc n'était pas le rouge mais le noir. Qu'allions-nous devenir, nous demandions-nous, dans un pays aussi différent ? Nous nous voyions - peuple de petite taille, armé de ses seuls livres - débarquer au pays des géants. Se moquerait-on de nous ? Nous cracherait-on dessus ? Nous prendrait-on seulement au sérieux ? Toutefois, même les plus réticentes admettaient qu'il valait mieux épouser un inconnu en Amérique que de vieillir auprès d'un fermier du village. Car en Amérique les filles ne travaillaient pas aux champs, il y avait plein de riz et de bois de chauffage pour tout le monde. Et partout où l'on allait, les hommes tenaient la porte aux femmes et soulevaient leur chapeau en disant : "Les dames d'abord" et "Après vous".
Sur le bateau certaines d'entre nous venaient de Kyoto, elles étaient blanches et délicates car elles avaient passé leur vie dans des pièces sombres, au fond des maisons. Certaines venaient de Nara, elles priaient leurs ancêtres trois fois par jour et juraient entendre encore sonner les cloches du temple. Certaines étaient filles de paysans de la région de Yamaguchi, elles avaient les épaules larges, les poignets épais et ne s'étaient jamais couchées au-delà de neuf heures du soir. Certaines étaient issues d'un petit village de montagne de Yamanashi et avaient découvert le chemin de fer il y a peu. Certaines venaient de Tokyo, elles avaient tout vu, parlaient un japonais très beau et ne se mêlaient guère aux autres. Beaucoup étaient de Kagoshima et baragouinaient un rude patois du Sud, que celles de Tokyo feignaient de ne pas comprendre. D'autres étaient d'Hokkaido, au climat froid et enneigé, et pendant des années elles rêveraient de ces paysages blancs. Celles qui venaient d'Hiroshima, où la bombe exploserait, avaient de la chance d'être sur ce bateau, bien qu'à l'époque nul n'en sache rien. La plus jeune d'entre nous avait douze ans et n'avait pas encore ses règles. Mes parents m'ont mariée pour avoir l'argent de la dot. La plus âgée, trente-sept ans, était de Niigata et avait passé sa vie à s'occuper de son père, un invalide dont la mort récente la rendait à la fois heureuse et triste. Je savais que je ne pourrais me marier que s'il mourait. L'une des nôtres venait de Kumamoto, où il n'y avait plus d'hommes valides - ils étaient tous partis l'année précédente chercher du travail en Mandchourie -, et s'estimait heureuse d'avoir trouvé un mari, quel qu'il soit. J'ai regardé son portrait et j'ai dit à la marieuse : "Ça fera l'affaire." Une autre était issue d'un village dans la région de Fukushima où l'on tissait la soie, son premier mari était mort de la grippe, le deuxième l'avait quittée pour une femme plus jeune et plus jolie qui habitait sur l'autre versant de la colline et, à présent, elle partait pour l'Amérique afin d'épouser le troisième. Il est en bonne santé, il ne boit pas, il ne joue pas, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. L'une d'entre nous avait été danseuse à Nagoya, elle était très élégante, avait une peau d'un blanc translucide et savait tout sur les hommes, aussi était-ce vers elle que chaque soir nous nous tournions pour lui poser nos questions. Combien de temps cela va-t-il durer ? Avec la lumière allumée ou dans le noir ? Les jambes en l'air ou posées ? Les yeux ouverts ou fermés ? Et si je ne peux pas respirer ? Et si j'ai soif ? Et s'il est trop lourd ? Trop gros ? Et s'il ne veut pas de moi ? "En vérité, les hommes sont très simples", répondait-elle. Puis elle se mettait à nous expliquer.
Sur le bateau parfois nous restions éveillées pendant des heures dans l'obscurité sombre et humide de la cale, remplies de désirs et de peurs, nous demandant com- ment nous tiendrions encore trois semaines.
Sur le bateau nous avions emporté dans nos malles tout ce dont nous aurions besoin dans notre nouvelle vie : un kimono de soie blanche pour notre nuit de noces, d'autres en coton coloré pour tous les jours, de plus discrets pour quand nous serions vieilles, et puis des pinceaux à calligraphie, d'épais bâtons d'encre noire, de fines feuilles de papier de riz afin d'écrire de longues lettres à notre famille, un minuscule bouddha de cuivre, une statuette d'ivoire représentant le dieu renard, la poupée avec laquelle nous dormions depuis que nous avions cinq ans, des sachets de sucre roux pour nous acheter des passe-droits, des couvertures éclatantes, des éventails de papier, des livres comportant des phrases en anglais, de petits sacs de soie imprimée de fleurs, des galets noirs polis par la rivière qui coulait derrière notre maison, une mèche de cheveux d'un garçon que nous avions un jour touché, aimé, à qui nous avions promis d'écrire, tout en sachant que nous ne le ferions jamais, le miroir d'argent donné par notre mère, dont les dernières paroles résonnaient encore à notre oreille. Tu verras : les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes.
Sur le bateau nous nous plaignions de tout. Des puces. De l'insomnie. Des punaises de lit. Du monotone ronron perpétuel du moteur qui nous poursuivait jusque dans nos rêves. Nous nous plaignions de la puanteur des latrines - énormes trous béants s'ouvrant sur la mer - et de notre propre odeur qui lentement mûrissait et devenait jour après jour de plus en plus fétide. Nous nous plaignions de la condescendance de Kazuko, de Chiyo qui se raclait sans cesse la gorge, de Fusayo qui fredonnait toujours La Chanson du cueilleur de thé, ce qui peu à peu nous rendait folles. Nous nous plaignions de nos épingles à cheveux qui disparaissaient - qui parmi nous était la voleuse ? - et du fait que les filles voyageant en première classe ne nous avaient jamais saluées depuis le pont supérieur, du haut de leur parasol de soie violette, malgré le nombre de fois où elles nous avaient croisées. Mais pour qui se prennent-elles, celles-là ? Nous nous plaignions de la chaleur. Nous nous plaignions du froid. Des couvertures de laine qui grattaient. De nos propres jérémiades. Au fond, pourtant, nous étions très heureuses pour la plupart d'entre nous, car bientôt, nous serions en Amérique avec nos futurs maris, qui nous avaient écrit bien des fois au cours des mois précédents. J'ai acheté une belle maison. Vous pourrez planter des tulipes dans le jardin. Des jonquilles. Ce que vous voudrez. Je possède une ferme. Je dirige un hôtel. Je suis président d'une grosse banque. J'ai quitté le Japon il y a des années pour fonder ma propre entreprise et je peux largement subvenir à vos besoins. Je mesure un mètre soixante-dix-neuf, je n'ai ni la lèpre ni de maladie des poumons, et il n'y a pas de fous dans ma famille. Je suis originaire d'Okayama. De Hyogo. Miyagi. Shizuoka. J'ai grandi dans le village voisin du vôtre et je vous ai vue il y a des années dans une foire. Je vous enverrai l'argent pour payer votre passage dès que possible.
Sur le bateau nous conservions la photographie de notre époux dans un minuscule médaillon ovale suspendu à notre cou au bout d'une longue chaîne. Nous la gardions dans une bourse de soie, une vieille boîte à thé, un coffret de laque rouge, dans la grosse enveloppe marron qui nous l'avait apportée d'Amérique. Nous la transportions dans les manches de notre kimono et souvent nous la touchions à travers le tissu pour nous assurer qu'elle était bien là. Nous l'emportions serrée entre les pages de Bienvenue, mesdemoiselles japonaises !, du Guide pour se rendre en Amérique, de Dix façons de faire plaisir à un homme, d'un vieux volume usagé de sutras bouddhistes, et l'une des nôtres, qui était chrétienne, mangeait de la viande et priait un dieu différent aux longs cheveux, l'avait rangée entre les pages de la bible du roi Jacques. Et quand nous lui demandions lequel elle préférait - l'homme de la photo ou le Seigneur Jésus lui-même -, elle nous adressait un sourire mystérieux et répondait : "Lui, bien sûr."
Sur le bateau plusieurs d'entre nous emportaient des secrets qu'elles se juraient de ne jamais révéler à leur mari. Peut-être qu'en réalité nous avions résolu d'aller en Amérique pour retrouver un père qui avait abandonné sa famille très longtemps auparavant. Il est parti travailler dans les mines de charbon du Wyoming et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Ou peut-être laissions-nous une fille, engendrée par un homme dont nous nous rappelions avec peine le visage - un conteur itinérant qui avait passé une semaine dans notre village, un prêtre bouddhiste errant qui s'était arrêté un soir tard chez nous, sur la route du mont Fuji. Nous avions beau savoir que nos parents s'occuperaient bien d'elle - Si tu restes ici, au village, nous avaient-ils prévenues, tu ne trouveras jamais de mari -, nous nous sentions coupables d'avoir choisi de privilégier notre vie aux dépens de la sienne et, durant le voyage, pendant bien des nuits nous avons pleuré en pensant à elle, jusqu'au matin où nous nous sommes réveillées en décrétant : "Ça suffit", et nous nous sommes mises à penser à autre chose. Au kimono que nous porterions le jour de notre arrivée. A notre coiffure. A ce que nous dirions quand nous le verrions. Parce qu'à présent nous étions sur le bateau, le passé était derrière nous et il n'y avait pas de retour possible.
Sur le bateau nous ne pouvions savoir que nous rêve- rions d'elle toutes les nuits jusqu'au jour de notre mort, que dans nos songes elle aurait toujours trois ans et demeurerait telle que nous l'avions vue en la quittant : une minuscule silhouette vêtue d'un kimono rouge sombre, accroupie au bord d'une flaque, totalement captivée par la vue d'une abeille morte flottant à la surface.
Interview de Julie Otsuka:
Parlons de l'auteur:
Née en 1962 en Californie, où elle a passé toute son enfance, Julie Otsuka, petite-fille d'immigrés japonais, a étudié les beaux-arts à l'Université de Yale et entamé une carrière de peintre. La trentaine venue, elle a décidé de se consacrer pleinement à l'écriture et publié en 2002 un premier roman très remarqué, Quand l'empereur était un dieu, paru deux ans plus tard en France : un livre inspiré par l'histoire de son grand-père, suspecté de trahison après l'attaque de Pearl Harbor en 1941 et interné dans un camp de l'Utah pendant trois ans. Julie Otsuka vit actuellement à New York.
♦Son blog
Née en 1962 en Californie, où elle a passé toute son enfance, Julie Otsuka, petite-fille d'immigrés japonais, a étudié les beaux-arts à l'Université de Yale et entamé une carrière de peintre. La trentaine venue, elle a décidé de se consacrer pleinement à l'écriture et publié en 2002 un premier roman très remarqué, Quand l'empereur était un dieu, paru deux ans plus tard en France : un livre inspiré par l'histoire de son grand-père, suspecté de trahison après l'attaque de Pearl Harbor en 1941 et interné dans un camp de l'Utah pendant trois ans. Julie Otsuka vit actuellement à New York.
♦Son blog
Bibliographie:
♦Quand l'empereur était un dieu → Éditions Phébus (2004)
♦Certaines n'avaient jamais vu la mer → Éditions Phébus (2012) / Editions 10/18 (2013)
♦Quand l'empereur était un dieu → Éditions Phébus (2004)
♦Certaines n'avaient jamais vu la mer → Éditions Phébus (2012) / Editions 10/18 (2013)
Les avis des copin(e)s: